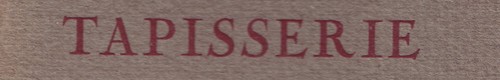
Je suis tombé sur un article particulièrement intéressant tiré du Bulletin de la vie artistique du 15 février 1923. Cette revue d’Art avait entre autres comme rédacteur Guillaume Janneau, administrateur général du Mobilier national et des manufactures nationales de Beauvais et des Gobelins. Le Bulletin avait organisé une grande enquête auprès de personnalités culturelles de l’époque. Cette enquête demandait à chacun trois noms d’artistes contemporains pour rénover la tapisserie. Cet article n’est qu’un extrait du dépouillement mais il a le mérite de donner le résultat final quand aux artistes plébiscités.
————————————
Pour rénover la tapisserie
NOTRE ENQUÊTE.
Poursuivons le dépouillement du scrutin. La publication des neuf réponses nouvelles qu’on va lire porte à trente-deux le nombre de celles qu’a jusqu’ici recueillies le Bulletin, et à quarante-neuf celui des artistes recommandés par nos confrères. Si l’on compte que chacun de nos correspondants fournit trois noms, ce sont donc quatre-vingt-seize suffrages qui se sont groupés sur un petit nombre de noms.
M. PAUL VITRY
Le vote que veut bien émettre ici M. Paul Vitry invoque ces « raisons de pratique » dont Oudry marquait jadis tant de mépris. Conservateur des musées nationaux, M. Paul Vitry n’est pas seulement un érudit : l’on n’a pas oublié qu’il présida, neuf ans durant, la Société des Artistes décorateurs. Il va manifester désormais son goût de la vie en assumant la rédaction en chef de Beaux-Arts, l’ancien petit supplément de la Gazette des Beaux-Arts, dont M. Georges Wildensiein et M. Théodore Reinach, ses co-directeurs, veulent faire une grande revue.
Il est bon de ne pas oublier le conseil de La Bruyère, même en matière de tapisserie : c’est un métier que de faire un livre comme de faire une pendule… ou un carton de tapisserie. Aussi je prendrais d’abord des gens qui sachent composer un décor et qui aient fait leurs preuves : Jaulmes ou Karbowsky. Puis s’il fallait un peintre dont le talent brillant et souple puisse s’essayer en cette matière délicate, je vote pour Lebasque.
M. LEON DESHAIRS
Bibliothécaire de l’Union centrale des Arts décoratifs, rédacteur en chef d’Art et Décoration, M. Léon Deshairs a suivi l’évolution des modernes avec autant de vigilance que d’indépendance. Les
travaux qu’il a signés comme les publications qu’il dirige témoignent un esprit judicieux, raisonnable et solide.
Vous m’embarrassez en ne demandant que trois noms. En tout cas, voici trois peintres qui, à mon avis, feraient de bons cartons pour Beauvais : Paul Vera, Jules Migonney et Hanicotte.
M. EMMANUEL DE THUBERT
S’il développe avec autant de flamme les arguments par lesquels il entend justifier son vote, c’est qu’en effet le rédacteur en chef de la Douce France, M. Emmanuel de Thubert, est un spécialiste de la tapisserie. Il a secondé, par une vigoureuse campagne, les initiatives qu’a prises, à l’école d’Aubusson, M. Marius Martin. Il a publié sur ce sujet vingt études qui font autorité. Aussi bien sommes-nous heureux de publier ici la véritable profession de foi que notre distingué confrère a bien voulu écrire à l’intention du Bulletin :
Depuis deux siècles, nos manufactures ont souffert de deux erreurs techniques qui sont également déplorables :
1 ° copie en fac-similé d’un modèle peint ;
2° abondance des tons;
l’une et l’autre de ces erreurs remontant aux progrès de la teinture au XVIIIe et au XIXe siècle.
Au XVIIIe siècle, Oudry, pour employer les nuances nouvelles que lui offrait la teinture, demande au tapissier le tissage en fac-similé du modèle peint. Au XIXe siècle, le tapissier, disposant de
toutes les ressources de la chimie, utilise un nombre illimité de couleurs dégradées à quinze nuances. Or, aux belles époques de la tapisserie, aux XIVe, XVe et XVIe siècles, l’ouvrier n’emploie qu’un nombre de nuances réduit : du ton le plus haut en valeur au ton le. plus faible, chaque couleur ne compte que trois ou quatre nuances. Ce petit nombre est suffisant. Comment,
compose, en effet, l’ouvrier? Le ton moyen lui fournit le ton local; le ton clair lui donne les modulations; les deux tons foncés lui permettent des accents.
Conséquence : les battages — c’est le nom que prennent les hachures dans la tapisserie, hachures verticales de préférence, — demeurent parfaitement écrits. C’est avec ces battages que l’ouvrier
assure les passages de tons, c’est avec ces battages qu’il module sa composition. Vous voyez donc combien il est important qu’il en fasse un emploi juste. Dans ces dernières années, pour protester contre les abus de la technique en fac-similé, certains artistes ont cherché leurs effets dans des teintes plates; cependant, le procédé du pochoir est tout aussi loin de la vérité du tissage que la copie des touches de la peinture. Le passage de tons par battages reste le moyen d’expression du tapissier.
Pour espérer une rénovation de la tapisserie, il nous faudra donc obtenir — et ici, je reprends les conclusions que donnait Marius Martin à son étude récente sur la Tapisserie de haute et de basse
lisse (pp. 26, 27, Paris, Editions de La Douce France, 1922) :
1° L’abandon de la technique en fac-similé du modèle; l’adoption de la technique d’interprétation, c’est-à-dire, dans les modelés, le remplacement du fondu, obtenu à l’aide de multiples nuances, par une modulation découlant du tissage : battages bien francs, bien visibles, écartant toute idée d’un effet de peinture.
(Les morceaux tissés de la sorte acquerront les qualités de la tapisserie. Notez encore que leur prix de revient sera bien inférieur.)
2° Il importe, en second lieu, que l’ouvrier ait à tisser de réels cartons de tapisserie, au lieu de ces peintures à l’huile que nous établissons avec un luxe de détails pour le moins inutile. Seront donc
proscrits tous les hasards de la touche, la virtuosité, l’habileté de main, le carton de tapisserie idéal devant se rapprocher du dessin rehaussé, être fait à tons limités et comptés.
(Notez qu’aux belles époques, les peintres de cartons interprétaient les tableaux des maîtres; jamais une peinture n’est reproduite littéralement, sauf au XVIIIe et au XIXe siècle. Il ne vous paraîtra donc pas excessif que nous demandions à nos modernes de faire une transposition qui paraissait si naturelle aux vieux peintres de cartons.)
Les principes étant établis, voici le nom des artistes que j’ai l’honneur de proposer au choix de M. l’administrateur de la manufacture de Beauvais. Un d’entre eux a déjà donné ses preuves, et
je me reprocherais de vous rappeler les travaux d’un atelier que vous estimez autant que moi. La peinture des deux autres me paraît immédiatement traduisible en tapisserie :
1 ° Paul Sérusier ;
2° Paul Deltombe ;
3° Charles Guérin.
Je suis heureux que M. l’administrateur de la manufacture de Beauvais prenne en souci la technique de la tapisserie ; mais je ne doute pas qu’il ne soit aussi désireux de la rendre à l’esprit qui lui est propre. Or, que représente la tapisserie, dans les belles époques? Pendant tout le cours de son histoire, elle nous donne une image de nos songes, de notre fantaisie, quand elle ne contient pas
des scènes d’abondance. Ce sont là, précisément, trois thèmes qui inspirent les peintres que je nomme : Charles Guérin, la fantaisie; Paul Deltombe, l’abondance; Paul Sérusier, le songe.
La tapisserie traite encore des scènes religieuses. Elle commémore, enfin, les grands événements de chaque époque. J’admets qu’il ne soit guère possible d’attendre de la manufacture de Beauvais la représentation de scènes religieuses; —l’Eglise, d’ailleurs, ne demande plus à des tentures tissées d’orner ses cérémonies. Quant aux grands événements de l’époque, ne sont-ils pas faits pour inspirer la tapisserie ? Evidemment si ! Et c’est avec raison que Flandrin a pris pour sujet de toute une suite de ses cartons : le Poilu.
Je consens qu’au début du travail de renouvellement qu’elle entreprend, la manufacture de Beauvais ne doive par rechercher de trop grandes difficultés. Reste, au moins, qu’elle peut, dès à présent, nous donner des pièces où nous retrouvions ce sentiment du mystère et de la joie qui appartient à la tapisserie. J’ajoute qu’en se réduisant là, la manufacture pourrait encore demander a trois autres peintres, dont l’un, disciple de Sérusier, a déjà fourni d’excellents morceaux de tissage : Paul Vera ; et dont les deux autres, s’ils se mettaient au service du métier, peindraient d’excellents cartons : Charles Dufresne et Georges Braque.
M. CLAUDE ROGER-MARX
Déjà, dans son courrier de Paris, M. Claude Roger-Marx avait répondu à notre enquête. Il veut bien répéter ici l’opinion qu’il y avait exposée, et, du coup, son vote accroît les chances de
deux maîtres, MM. Paul Signac et Maurice Denis.
A voir les dernières grandes décorations de K.-X. Roussel, on reste convaincu qu’il serait entre tous désigné pour dessiner des cartons dont l’exécution pourrait être admirable. Signac, Maurice Denis et d’autres encore, comme Braque et Dufy, sauraient participer très heureusement à la rénovation de la tapisserie de lisse.
M. LÉANDRE VAILLAT
Ce n’est point, comme notre ami M. Léandre Vaillat nous accuse de le croire, de désigner beaucoup de noms qui nous paraît difficile : c’est d’en choisir trois. Mais le critique spécialiste des questions d’art appliqué du Temps, l’auteur de maint ouvrage où le problème de la lisse est traité, ne laisse pas, en nommant ses candidats, de répondre au sphinx et de le faire quinaud.
Vous me demandez trois noms d’artistes capables d’exécuter des cartons pour la manufacture nationale des tapisseries de Beauvais. Je réponds, sans hésiter : Jaulmes, Jean Serrière, Dusouchel. Vous ne m’en demandez que trois, croyant sans doute qu’il est difficile d’en trouver davantage. Et cependant j’ai bien envie de vous en nommer d’autres : Dufresne, Dufy, Mare, Charles Guérin, Maurice Denis, Aman Jean, Albert Besnard, sans parler de Gaudissart, de Jeanès,- ni de Vera qui a déjà travaillé pour la manufacture.
M. MAURICE RAYNAL
Concluons celle avant-dernière consultation en publiant la réponse de notre courageux confrère de /’Intransigeant, M. Maurice Rainai. C’est une Vue nouvelle, fort originale et fort ingénieuse, qu’il ouvre sur le problème. L’on n’attendait pas moins de l’esthéticien qui vient d’écrire, sur Picasso (chez Crès), un livre intelligent.
Au risque d’attirer sur moi les foudres de la peinture, je dirais volontiers ceci à M. Jean Ajalbert :
« Pourquoi-ne pas fournir tout simplement aux professionnels de la tapisserie la culture artistique nécessaire pour qu’ils puissent la rajeunir eux-mêmes? Potiers et meubliers demandent-ils conseil aux peintres ? Et ne vaudrait-il pas mieux laisser ceux-ci à leurs pinceaux et à leurs toiles, domaine où ils ont pas mal à faire, et leur éviter de se copier eux-mêmes une fois de plus, et.ici suivant des moyens qui ne sont pas les leurs? » …….
Le dépouillement place donc les artistes nommés dans la situation suivante :
- MM. Braque, Charles Dufresne et Raoul Dufy recueillent quatre suffrages,
- MM. Paul Signac, Maurice Denis, Jules Flandrin, Jaulmes, Paul Vera, Valtat, trois,
- Mlle H. Dufau, MM. Charles Guérin, K.-X- Roussel, René Piot, Paul Deltombe, Henry de Waroquier, Migonney, Maillaud et d’Espagnat, deux.
![[ AUBUSSON ]](https://www.saintrapt.com/aubusson/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/cropped-titre1-1.jpg)
Poster un Commentaire