Aussi surprenant soit-il, pour une fois ce n’est pas d’un auteur aubussonnais dont on va parler ce jour mais d’un auteur bien plus parisien que nantais (sa ville natale). Il a pourtant la particularité d’être contemporain de nos 2 plus grands hommes de lettres aubussonnais et bien d’autres non moins célèbres, ce qui nous permet, grâce à lui, de nous plonger dans cette époque.

Charles Monselet, journaliste, poète et romancier français, est né en 1825 à Nantes et décédé en 1888

Fils de libraire nantais, il publie ses premiers poèmes à l’âge de 14 ans et s’exile rapidement à Paris où il se lie d’amitié avec Baudelaire, Nerval et Gautier, deviendra intime avec les Goncourt.
Si Charles Monselet est un touche à tout, il excelle surtout dans le domaine des lettres, et plus particulièrement en tant qu’auteur de courts billets publiés dans les nombreux quotidiens parisiens de l’époque dans lesquels ils expriment toute sa verve polémiste sans aucune hypocrisie.
Nombreux de ses billets ont été publiés en recueil.
Mais il est aussi un habile plagiaire, et a la capacité exceptionnelle de pasticher Flaubert, Goncourt, Léon Cladel, Zola de manière totalement déconcertante, et il n’est guère intéressé par ces auteurs à la mode, il préfère dénicher, déterrer des écrivains oubliés ou ignorés et leur accorder un des plus célèbres de ces ouvrages « Les Oubliés et les dédaignés » consacré à la réhabilitation d’auteurs méconnus du XVIIIe siècle.
En 1849, il travaille pour « Le Corsaire » qui s’imprimait rue d’Enghien et qui comptait parmi ses rédacteurs Paul Féval, Théodore Barrière, Murger, Théodore de Banville, Auguste Vitu, Fauchery, Privat d’Anglemont et aussi un certain Jules Sandeau.
En 1857, parait « La Lorgnette littéraire », Dictionnaire des grands et des petits auteurs de mon temps, (2nd plus célèbre de ses ouvrages) brèves notices humoristiques sur ses contemporains hommes de lettres publiées sous formes de billets dans « la Gazette de Paris » impressions subjectives, nonchalantes, jugements à l’emporte-pièce désinvolte, mais toujours exprimés en quelques lignes plutôt drôles sans animosité particulière.
En 1858, il fondait le journal hebdomadaire « Le Gourmet », qui ne fut publié que quelques mois, il n’en est pas surprenant que ces proches l’aient surnommé « roi des gastronomes ». Il mettra en sonnets son amour de la table (un de ces plus célèbres) :
Mignonne allons voir si les huîtres
Sont ouvertes au restaurant…
et sera en ce XIXème siècle un des inventeurs de l’art de la chronique gastronomique.
Personnage truculent et décalé… comme le démontre cette anecdote : Pendant trente ans, il vécut de critique théâtrale au « Monde Illustré » sans jamais assister aux pièces dont il rédigeait la critique, tout simplement comme le disait-il “afin de ne pas être influencé“.
Monselet aura publié des centaines d’articles et près de quatre-vingts volumes de poèmes, romans, parodies, plagiats, chroniques, essais et critiques.
Il aurait eu avant de s’éteindre cette dernière parole : »J’aurai un enterrement aux truffes«
Chaque année est décerné le prix Charles Monselet, non pas un prix littéraire mais un prix gastronomique.
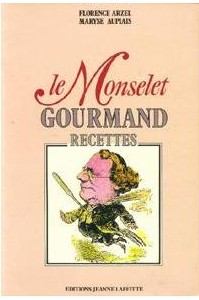
Après cette présentation, voilà ce que l’on peut lire dans ces écrits concernant nos deux hommes de lettres aubussonnais :

Jules Sandeau, dans « La Lorgnette Littéraire (Dictionnaire des grands et petits auteurs de mon temps – reste à savoir dans laquelle des 2 catégories, il plaçait Sandeau)
Il y a des auteurs pour dames, de même qu’il y a des bottiers pour dames. M. Jules Sandeau est de ces premiers. C’est le Kotzebue français : il ne lui manque que la redingote à rotonde et les bottes à gland. Après bien des nouvelles sensibles et bien des romans élégiaques, M. Jules Sandeau a été nommé conservateur à la Bibliothèque Mazarine. La Bibliothèque Mazarine, c’est le purgatoire de l’Institut.
Dans un autre des ses écrits « La Police Littéraire », Monselet mélange fiction et réalité en faisant intervenir Sandeau dans une scène quelque peu pathétique…
III
Je me suis rendu ce matin à la bibliothèque Mazarine, dont M. Jules Sandeau est un des conservateurs.
La solitude de ce docte lieu n’était troublée que par les grandes enjambées de M. Daremberg, qui allait de la salle de lecture à la salle des monuments pélasgiques, et par les éternuements d’un orientaliste en manteau vert. Dans un coin, le garçon Théophile apposait avec gravité sur les envois du ministère de l’instruction publique le timbre rouge de la bibliothèque orné du chapeau de Mazarin. Je vis le long des tables une menue collection de lecteurs parmi lesquels il me fut aisé de reconnaître, – à son odeur développée par le chauffage de la salle, – ce savant dont l’habit est recouvert d’une épaisse couche de colle-forte sur toutes les coutures ; pauvre savant qui n’a ni femme, ni sœur ni mère, ni maîtresse, ni servante, et qui n’a trouvé, dans la naïveté de son esprit, que ce seul moyen de suppléer à l’usage de l’aiguille et du fil !
M. Jules Sandeau est arrivé à onze heures ; il s’est assis avec une certaine mélancolie à son pupitre, entre les deux fenêtres qui regardent le pont des Arts. C’est un homme au crâne dévasté, ressemblant par le nez à M. Véron, et par les yeux à M. Paul de Kock.
J’ai été à lui et je l’ai prié de me faire donner le livre intitulé : « Jamblicus, de Mysteriis Ægyptiorum, Chaldæorum, Assyriorum ; Proclus, in Platonicum Alcibiadem de Animâ atque Dæmone ; Proclus, de Sacrificio et Magiâ, etc. Venetiis, in ædibus Aldi et Andreæ soceri. 1516, in-folio. »
M. Jules Sandeau a paru un peu troublé ; il m’a fait répéter trois fois et a consulté le catalogue ; puis il a fini par me dire que l’ouvrage était en lecture – chez madame Virginie Ancelot.
Un quart d’heure après, je me suis ravisé, et, voulant faire un acte de bon goût vis-à-vis d’un romancier dont les oeuvres m’ont souvent procuré d’agréables émotions, je suis revenu lui demander, le sourire aux lèvres, le Docteur Herbeau. – M. Jules Sandeau a rougi jusqu’aux oreilles, et il m’a répondu d’un ton sec que la bibliothèque Mazarine ne prêtait pas de romans.J’ai regagné ma place et j’ai réfléchi.
En me voyant, quelques minutes plus tard, me lever de nouveau et reprendre le chemin de son pupitre, M. Jules Sandeau s’est emparé précipitamment de son chapeau et a quitté la bibliothèque, en grommelant.
BIBI-LUBIN.
Monselet a aussi écrit sur Alfred ASSOLANT (dans « De A à Z, Portraits Contemporains »)
« Je reviendrai » s’est écrié Alfred Assolant en dirigeant un poing menaçant vers le banc des ducs.
Je connais Assolant,; il le fera comme il dit : il reviendra.
Il reviendra tous les ans, tous les six mois, tous les trois mois, selon que la Parque fauchera plus ou moins parmi les prétendus Immortels.
Mais quelle singulière mouche a piqué Alfred Assolant ? Et d’où vient que notre ardent confrère se laisse tenter par ce que l’on appelle le style académique ?
Il existe un style académique, hélas ! on ne saurait le nier.
C’est de tous les styles, celui qui éblouit le plus et qui abuse le mieux.. on le reconnaît immédiatement à sa perruque volumineuse, à son jabot et à ses manchettes de dentelles, à sa démarche importante, à ses gestes cadencés, à ses talons frottés de rouge.
C’est le style endimanché par excellence…
(Et là pendant 5 pages, Monselet va s’évertuer à se moquer ouvertement de ce style ampoulé que serait le style académique auquel A. Assolant se serait laissé tenter… et pour conclure) :
… Voilà donc la coupe où voudrait s’abreuver Alfred Assolant !
Qu’il lise le pastiche auquel je viens de m’amuser, et il en frémira peut-être; et peut être murmurera-t-il : « C’est donc ainsi que j’aurais été dimanche ! ».
Alors, sans doute, Alfred Assolant renoncera à sa candidature perpétuelle à l’Académie Française.
Comme Banquo surgissant au milieu d’un festin, il a produit son effet, une deuxième, une troisième apparition seraient d’un goût contesté. On serait en droit de lui dire en lui tapant sur l’épaule :
« Ami Banquo, rentrez chez vous; vous êtes d’une autre Académie qui vaut bien celle-ci, et dont votre confrère Arsène Houssaye a écrit l’histoire : l’Académie du quarante et unième fauteuil ! »
![[ AUBUSSON ]](https://www.saintrapt.com/aubusson/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/cropped-titre1-1.jpg)
Poster un Commentaire