Vous le savez si vous lisez nos pages, Jean-Luc de Ochandiano est l’auteur de « Lyon, un chantier Limousin ». Comme il sera à Aubusson et Felletin pour dédicaces, ce Samedi 13 de 10h à 12h30 à la librairie La Licorne (42 Grande Rue, 05 55 66 13 64) et de 15h à 18h à la Maison de la Presse de Felletin (3 Grande Rue, 05 55 66 41 55), je me suis permis quelques questions autour de ce livre, histoire d’éveiller la curiosité… Merci donc, Jean-Luc, pour ces réponses qui nous font découvrir un vrai passionné.

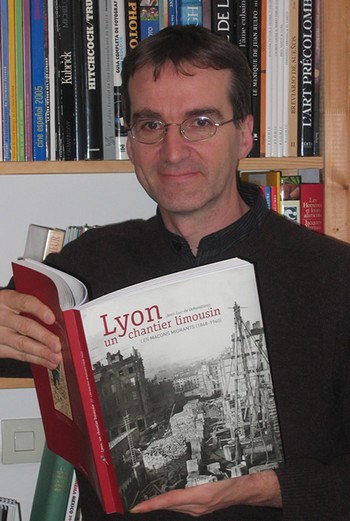
– Jean-Luc de Ochandiano, dans la Creuse, on a l’habitude de dire que nos ancétres ont construit Paris, vous élargissez notre champ de construction avec votre livre « Lyon, un chantier limousin ». Comment en êtes vous arrivé à étudier la construction lyonnaise et l’implication des limousins dans cette construction ?
Il y a plus de dix ans, je voulais faire un mémoire de maîtrise sur les grèves de 36 à Lyon mais, du fait de la taille de cette ville, il était difficile de mener l’étude en un an sur l’ensemble des secteurs industriels touchés par cette vague revendicative. J’ai alors décidé de centrer mes recherches sur le bâtiment qui avait été peu étudié contrairement à la métallurgie ou au textile. Puis les choses se sont enchaînées naturellement et maintenant je réalise une thèse sur le bâtiment à Lyon entre 1848 et 1940.Très tôt, j’ai croisé les Limousins, en particulier dans la maçonnerie, et je me suis rapidement rendu compte qu’ils jouaient un rôle essentiel dans ce secteur. Les sources les concernant étant nombreuses et diversifiées, il n’a pas été difficile de décider de leur consacrer l’ouvrage que je viens de publier.
– Ici il y a quelques jours, en commentaire, Roland Nicoux de l’association des Maçons de la Creuse rappelait que 35 000 Creusois, migrants du batiment, partaient chaque année de nos contrées. J’imagine qu’ils ne racontaient pas tous leur histoire dans des livres. Comment entre-t-on dans la vie de ces centaines d’anonymes ? Quelles sources utilise-t-on ?
En dehors de Martin Nadaud, dont le témoignage sur la maçonnerie à Paris dans la première moitié du 19e siècle est exceptionnel, peu de migrants du bâtiment ont laissé des témoignages et aucun sur Lyon. Malgré tout, il est possible de reconstituer des éléments de la vie des ces milliers d’hommes qui se sont succédés sur les chantiers lyonnais. En histoire sociale, une des premières sources d’information est constituée par… les archives de police. Jusqu’à la 3e république, les autorités se méfiaient des migrants qu’elles soupçonnaient d’être des fauteurs de trouble. Elles essayaient donc de contrôler ces populations afin de prévenir tout risque de débordement. Cette surveillance a produit une masse documentaire qui est très riche en informations de toutes sortes mais qu’il faut analyser avec attention car les préjugés contre les migrants étaient forts et biaisaient le regard porté sur eux. A côté des archives policières, on trouve une foule de documents qui peuvent servir à alimenter la recherche : ceux produits à l’occasion des chantiers publics et qui sont généralement conservés, les archives du ministère du travail à partir de sa création au début du 20e siècle (rapports d’inspecteurs du travail sur les accidents, enquêtes, etc.). Les archives syndicales sont très riches à Lyon tant du côté patronal qu’ouvrier, de même que les archives d’entreprises de maçonnerie. Les recensements nous apprennent aussi beaucoup sur la localisation des migrants du Limousins. En réalité, les documents ne manquent pas mais il faut les étudier avec méthode et y passer beaucoup de temps… Je suis loin d’avoir épuisé le sujet. Il en reste pour d’autres
– Pour vous qui l’avez étudié, la vie de ces migrants est-elle une anecdote dans l’Histoire ou croise-t-elle régulièrement celle du siècle ?
Je pense sincèrement que la vie de ces migrants du Limousin est loin d’être anecdotique. Evoquer leur histoire, c’est aussi parler des transformations profondes qu’a connu notre pays depuis le milieu du 19e siècle : l’industrialisation et le développement du monde urbain qui provoquent un exode rural sans précédent, l’apprentissage du monde urbain pour des ruraux arrachés à leur terre, le développement du monde ouvrier aux marges des villes et la naissance d’une culture ouvrière d’un type nouveau, l’intégration des valeurs nationales pour des populations qui vivaient jusqu’alors repliées sur le groupe local, toutes ces transformations ont profondément marqué notre société et sont au coeur de ce qu’ont vécu les Limousins à Lyon ou à Paris. Parler de l’histoire des Limousins entre 1848 et 1940, c’est évoquer, sous une forme particulière, la naissance de notre société.
– Vous venez dédicacer votre livre à Aubusson entre autres, aviez-vous des attaches en Limousin avant cette étude ? Ou est-ce la découverte de ces migrants qui vous a amené au chemin inverse ?
Je n’ai aucune attache limousine et je n’avais jamais mis les pieds dans votre région avant de m’intéresser à ce sujet. Mais la « fréquentation régulière » des maçons migrants que je rencontrais dans les archives m’a donné envie de connaître cette région, notamment le plateau de Millevaches et les Combrailles qui étaient les deux zones géographiques qui envoyaient le plus de maçons à Lyon. Des amis creusois m’ont permis de venir régulièrement dans votre région qui m’a immédiatement charmé. J’y retourne maintenant régulièrement et je la retrouve toujours avec plaisir, et une certaine émotion car j’ai l’impression qu’elle m’est familière. Par exemple, si je visite un cimetière du plateau de Millevaches, je connais la plupart des noms qui sont inscrits sur les tombes, comme s’il s’agissait de parents lointains, inconnus mais pourtant proches. Par ailleurs, j’ai trouvé une grande chaleur humaine dans le Limousin et des paysages magnifiques, ce qui ne gâche rien.
![[ AUBUSSON ]](https://www.saintrapt.com/aubusson/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/cropped-titre1-1.jpg)
Poster un Commentaire