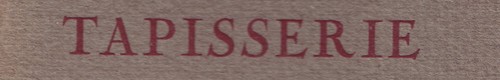
La France à Table est une revue fondée en 1934 par Maurice Edmond Sailland (1872-1956), dit « Curnonsky» ou le « Prince des Gastronomes », qui est connu pour avoir inventé la critique gastronomique. La France à Table, édité par Gaston Pinget, consacre chaque numéro à une province ou à un département en faisant le tour de la gastronomie locale mais aussi du tourisme et de diverses spécialités. La revue va traverser toutes les régions avec une belle longévité: Le numéro 1 dédiée à la « Savoie », paraît en mai 1934, le dernier, presque 200 numéros plus tard, en juillet 1978. En décembre 1951, elle passe par nos contrées et c’est François Tabard qui signe une rapide histoire de la Tapisserie locale que voici :
TAPISSERIE D’AUBUSSON par François TABARD
Dans le mystère qui enveloppe les origines de la fabrication de la Tapisserie à Aubusson, il est difficile de faire une part exacte à l’histoire et à la légende. Dès le XVIe siècle, il existait une tradition attribuant aux Sarrazins l’introduction de la tapisserie à Aubusson.
Des Arabes fugitifs, errant dans le pays après la destruction de l’armée sarrasine à Poitiers en 732, se seraient installés sous les murs du Château pour y exercer leur industrie qui se trouva dès lors fixée à Aubusson. Cette légende est pittoresque; elle n’est d’ailleurs pas invraisemblable et a été souvent rapportée comme fait historique par la plupart des écrivains qui se sont intéressés à l’histoire de la Creuse. Il est cependant plus probable que l’art d’exécuter la tapisserie à Aubusson a été importé des Flandres au xiv e siècle par Marie de Hainaut, comtesse de la Marche. Les plus anciennes tapisseries connues que l’on puisse attribuer aux ateliers marchois (et encore les avis sont-ils partagés sur ce point) sont les six somptueuses tapisseries dites de la « Dame à la Licorne» exécutées en 1490 et qui furent transférées en 1882 du Château de Boussac (Creuse) au Musée de Cluny. De nombreux documents relatent l’activité des ateliers marchois au XVe et au XVIe siècles. Nous en retrouvons des réalisations dans les collections privées et dans les musées.
Datant du XVIe siècle, la splendide suite de 10 tapisseries d’Anglard de Salers à décor de feuillages en volutes agrémenté d’une flore et d’une faune fantastiques témoigne de la perfection du travail aubussonnais à cette époque et de sa valeur esthétique.
C’est à dater du XVIe siècle et au cours des siècles suivants que nos cathédrales, nos églises, nos monastères, les châteaux de la noblesse et les demeures de la riche bourgeoisie vont se peupler de ces innombrables tapisseries d’Aubusson qui constituent une des richesses artistiques de la France. Ce n’est cependant pas sans vicissitudes que ce beau métier d’art a pu, au cours des siècles et sans discontinuité, se maintenir vivant sur les bords de la Creuse.
Les guerres, les révolutions, les bouleversements sociaux qui s’en suivirent, furent autant de facteurs qui, sur le plan économique, portèrent à cette industrie des coups terribles dont elle sut cependant toujours se relever.
Sur le plan artistique, Aubusson connut aussi des défaillances qui, au XVIIe et au XVIIIe siècles, motivèrent l’intervention royale. Sur l’action de Colbert, octroi par Louis XIV aux manufactures d’Aubusson, d’une véritable charte de l’industrie de la tapisserie puis, sous Louis XV, création à Aubusson d’écoles de dessin et de peintures, d’un office de peintre pour le roi et de tout un système de contrôle de la production. Si ces dispositions eurent des répercussions heureuses sur la marche de cette industrie et lui redonnèrent un nouvel essor, si les tapisseries tirées des compositions de Boucher, Oudry, Lancret, Watteau, etc. connurent auprès d’une société élégante et frivole une vogue extraordinaire, il n’en reste pas moins que ces œuvres du XVIIIe siècle, réalisées dans une technique trop habile, à l’aide d’une multitude de nuances n’avaient plus le caractère décoratif de leurs devancières de l’époque médiévale et de la Renaissance.
En tendant à l’imitation de plus en plus poussée de la peinture de chevalet, la tapisserie avait perdu son propre caractère. Le XIXe siècle vécut sur ces mêmes errements et ce n’est que dans la dernière décade de notre demi-siècle que l’on put assister à Aubusson à une véritable renaissance de la tapisserie.
Revenant aux saines traditions techniques de l’époque médiévale, limitant le nombre des nuances, remplaçant les dégradés par de vigoureuses hachures, ne visant plus à suggérer l’impression d’une peinture, la tapisserie a décorativement et dans une esthétique neuve, reconquis le mur. Si, depuis longtemps, la nécessité d’un renouvellement artistique de la tapisserie s’imposait à l’esprit des dirigeants les plus avertis de cette industrie, si de nombreuses recherches avaient été faites dans le sens de l’épuration de la technique, ce n’est guère qu’en 1938 avec Jean Lurçat que fut fait un grand pas en avant.
Ce grand artiste français apportait à Aubusson, joints à son talent, à sa connaissance de la décoration du mur, à l’acceptation des impératifs d’une saine technique, une volonté et un dynamisme qui devaient faire de lui un chef d’école. Dès 1939, un autre grand artiste français, Marcel Gromaire, faisait bénéficier lui aussi l’industrie aubussonnaise d’une précieuse et importante collaboration. Puis ce sont, en 1940, 1941, 1942, Pierre Dubreuil, Raoul Dufy, Maurice Brianchon, Dont Robert de Chaunac, Lucien Coutaud, Maurice Savin, Marc Saint-Saëns, Charles Walch, Hélène Détroyat, Jean Picart le Doux, qui viennent successivement ou simultanément mettre leur art au service de la décoration murale en matière textile.
De la phase des recherches, on est maintenant résolument passé à celle des réalisations et la tapisserie prend une place de plus en plus importante dans le domaine des arts. Le mouvement va grandissant ; de très nombreux artistes dont la liste serait longue sont venus apporter à Aubusson des éléments nouveaux reflétant les différentes tendances esthétiques de notre époque, mais respectant d’une façon générale dans leurs œuvres, il faut le noter, une unité de conception technique qui est la condamnation absolue de la tapisserie simili-peinture.
Depuis la fin de la guerre, des milliers de tentures modernes ont été réalisées, des centaines d’expositions de tapisseries contemporaines organisées en France et à l’étranger, dont celle de la Tapisserie française au Musée d’Art Moderne, en 1946, fut le point de départ.
Le climat créé autour de notre art aubussonnais ne peut être meilleur et seules les grosses difficultés économiques du moment freinent son plus grand épanouissement.
Une ère nouvelle s’est indiscutablement ouverte dans l’histoire de la tapisserie.
Sans doute, et cela est souhaitable, une certaine évolution esthétique pourra, dans les jours à venir, avoir son influence sur les productions d’Aubusson, mais le mouvement actuel est établi sur des bases solides. La tapisserie a été réhabilitée, artistiquement et techniquement, et elle est redevenue, après une longue éclipse, l’expression d’une branche importante de l’art français.
François TABARD.
![[ AUBUSSON ]](https://www.saintrapt.com/aubusson/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/cropped-titre1-1.jpg)
Poster un Commentaire